Pont de Pontoise - XVIIème au XIXème siècle - XVIème siècle
Fleuve franchi : l'Oise, département : Val-d'Oise, à proximité : Pontoise
Type d'ouvrage : Pont en pierre ou maçonné
Nombre d'arches/travées : 5
Version du texte : V1.2, Niveau de fiabilité : fort
| Plan de Région Parisienne |
 |
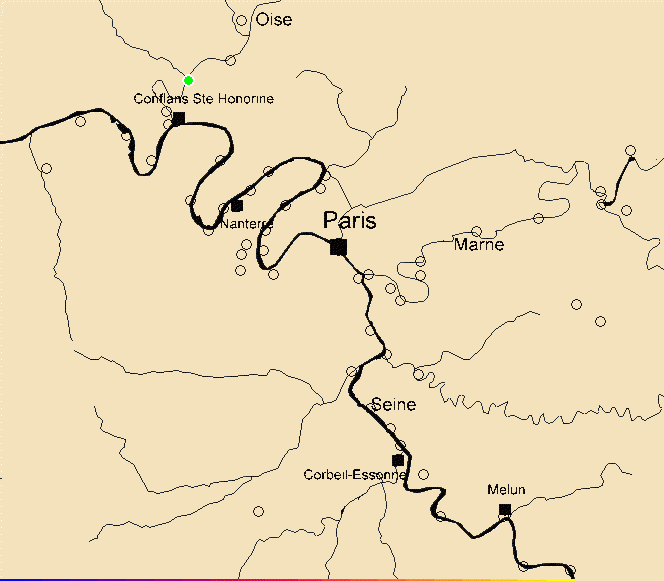
|
Les ouvrages dans la même ville de Pontoise:
Tous les ouvrages, Vieux pont de Pontoise - Xème siècle, Pont de Pontoise - XVIIème au XIXème siècle - XVIème siècle,Références :
Selon l'ouvrage en référence, le premier pont de pierre à Pontoise, sur l'Oise fut bâti peu de temps après le baptême par l'Archevêque de Rouen, du chef des Normands, Rollon en 912.
Situé vis à vis de la Citadelle, il comportait 12 arches. Il se substituait à un pont de bois, situé à la tête de l'île, appelée désormais (1841), île Saint-Martin, qui tombait en vétusté et qu'une inondation venait de rendre impraticable.
Son entrée, sur la rive gauche était coupée par un pont levis et défendue par une énorme bâtisse. L'autre entrée était flanquée de deux tours de défense.
Vers 1600, le pont de l'Oise portait six établissements de boucherie, affermés au nom de la ville, et cinq autres maisons à son extrémité. Il portait aussi 3 moulins !
Le deuxième ouvrage nous apprend que ce pont fut détruit en 1680.
Selon (4), un projet de pont fut établi par Jean-Rodolphe Perronet en 1772 mais semble ne pas avoir abouti. Et pourtant ce projet était très détaillé : 3 arches de 90 pieds (29.24m) d'ouverture, en arc de cercle, une largeur de 39 pieds (12.67m).
Le pont existant au début du XIXème siècle date du XVIème siècle. Il est constitué de 5 arches. Sur le milieu de sa longueur était une espèce de fortification qui a été démolie pendant la Révolution. Il était aussi fermé par des portes à ses deux extrémités.
En 1839, des travaux sont entrepris, autorisés par ordonnance royale pour sa restauration et la construction de quais, ce que confirme l'ouvrage de l'abbé Trou.
